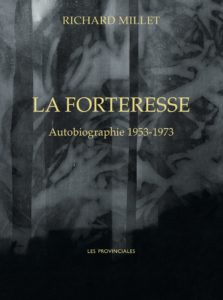 « Je vais où me portent mes phrases. » Richard Millet achève la longue quête vers l’origine dans laquelle il s’est lancé peut-être le jour où il commença d’écrire il y a cinquante ans la première ligne de son œuvre abondante et décisive aujourd’hui – décisive pour la survie du pays et de la langue où il est né : si elle n’y trouve bientôt sa véritable place, c’est que la langue de ce pays sera morte. Ce livre n’est pas un livre de confessions, bien que « animé à l’excès par l’esprit de sérieux », et soucieux de « détruire toute complaisance envers moi-même », d’arracher « les vieux masques », y compris celui de l’homme « qui pose, inévitablement, en écrivant – et en vivant », il se situe dans l’exacte lignée de saint Augustin, dont il partage la quête de cette « connaissance surnaturelle » qui se rend sensible « sous la forme de l’amour ». « C’est plutôt un cheminement vers ce qui me demeure obscur », et le livre que « j’ai toujours été en train d’écrire, pas à pas, et jusque dans le songe du grand livre qui mettrait fin à mon entreprise littéraire ».
« Je vais où me portent mes phrases. » Richard Millet achève la longue quête vers l’origine dans laquelle il s’est lancé peut-être le jour où il commença d’écrire il y a cinquante ans la première ligne de son œuvre abondante et décisive aujourd’hui – décisive pour la survie du pays et de la langue où il est né : si elle n’y trouve bientôt sa véritable place, c’est que la langue de ce pays sera morte. Ce livre n’est pas un livre de confessions, bien que « animé à l’excès par l’esprit de sérieux », et soucieux de « détruire toute complaisance envers moi-même », d’arracher « les vieux masques », y compris celui de l’homme « qui pose, inévitablement, en écrivant – et en vivant », il se situe dans l’exacte lignée de saint Augustin, dont il partage la quête de cette « connaissance surnaturelle » qui se rend sensible « sous la forme de l’amour ». « C’est plutôt un cheminement vers ce qui me demeure obscur », et le livre que « j’ai toujours été en train d’écrire, pas à pas, et jusque dans le songe du grand livre qui mettrait fin à mon entreprise littéraire ».
Après avoir accompagné jusqu’à la mort les « deux femmes aux prénoms magnifiques » qu’il avait successivement épousées, l’une l’ayant quitté car il ne voulait pas lui donner l’enfant qui aurait compromis sa vocation excessive et sacrificielle à la littérature, l’autre lui ayant donné deux filles en plus du déchirement de la mort et du deuil, donc cette autre sorte d’amour que cela implante en vous – Richard Millet entreprend le récit autobiographique de ses vingt premières années que ne couvrent ni son Journal ni son œuvre romanesque et c’est pour y découvrir, peut-être, « l’origine de ma sensualité », c’est-à-dire d’où lui vient ce désir insatiable et douloureux dont il aura émaillé tant de pages de son œuvre mais qu’il juge proche de la malédiction d’un homme « quasi damné par sa complexion sensuelle ». Bien loin pourtant de ces érotomanes européens, qui furent si souvent les proies de penchants faisant d’eux à la fois des athées sans frein moral et des indécis, il aura très tôt arrêté que « jamais je n’ai porté la main sur une femme sans qu’elle m’y ait invité par un de ces signes qui sont l’apanage de son sexe et qui font du consentement une manifestation de la grâce ». Richard Millet place cette quête dans l’ordre de la conversation intime avec l’absolu, les morts continuant de lui parler « bien mieux que les vivants » et le mot de deuil recouvrant aussi « une énigmatique forme d’amour ». « Je suis entièrement du côté des défunts. » Sa « vie parmi les ombres » est cette quête dans le « labyrinthe intérieur au fond duquel se trouve un minotaure », la corne du taureau selon Michel Leiris. Richard Millet sait, a appris par la guerre, par le deuil et par la maladie que ce taureau est « une figure littéraire », celle que chacun « invente en son propre labyrinthe », donc « une sorte de cliché, qu’il s’agit d’identifier et de mettre à mort par l’écriture, ou la prière. » C’est cela, l’effort de totale sincérité et la détermination inflexible d’aboutir, la maîtrise de soi (« les forces qui résistent à la mort sont aussi celles qui s’y résignent ») qui donnent à ce livre sa gravité singulière, sa grandeur et, une fois celui-ci mené à bien, la lueur d’espoir de parvenir au but « si tant est que ce soit possible, et que l’inachèvement, voire l’échec, ne soit pas sa loi, ou celle de ma vie tout entière. »
Cette quête il l’appelle donc tantôt « une enquête sur l’origine de ma sensualité », tantôt une quête du livre : « Mon projet n’est-il pas la baleine blanche de mon entreprise littéraire ? Je n’aurai tué aucun cerf fabuleux, nul sanglier mythologique ; et je ne suis… même pas un chevalier errant et pauvre. Seul le suicide me hante, comme une consolation, en une mélancolie avec quoi j’aurai rusé toute ma vie. Je ne suis rien – c’est-à-dire écrivain ; et j’en reviens encore à l’idée que j’aurai vécu sans vivre. » Cette situation a longuement fait de lui un être voué au retranchement dans « la forteresse intérieure », et au secret : « l’écriture restant, malgré le fort sentiment d’imposture qui s’y attache, la seule chose qui dépose entre mes mains un peu de la chair du monde. » Auteur d’environ soixante-dix livres dont « je ne suis pas persuadé qu’ils resteront mais qui m’auront, peut-être, permis d’écrire celui-ci », il se sent encore « une espèce de rhéteur qui se dérobe à mesure qu’il avance » : « un écrivain n’écrit-il pas pour se taire ? » et c’est pourquoi il entreprend méthodiquement et peut-être désespérément de produire par sa phrase la « déconstruction » de cette « imposture ». « Je n’existe donc vraiment que dans le rythme que je donne à ma phrase, et c’est pour mieux y disparaître. » Aristote disait : s’immortaliser poétiquement, ἀθανατίζειν.
Cette quête apparaît donc aussi une échappatoire, la libération d’une sorte d’envoûtement paternel. « J’irai, vaillant petit soldat, à l’origine non de ma sensualité, comme j’en avais eu l’intention, mais d’une sorte d’envoûtement paternel… » La brutalité de celui qui le battait assez vivement, comme l’évêque de Fanny et Alexandre, ce tyran, ce dictateur qui l’humiliait au point d’installer en lui une mélancolie tenace, une culpabilité, et qui corrigera jusqu’à la fin, avec dédain, le français de son fils devenu écrivain de premier plan, « l’idée qu’il trouve mon style médiocre et ma syntaxe fautive est une des raisons pour lesquelles j’ai si souvent reculé devant ce livre » : c’est ce père qui, « même mort, continue à montrer le visage qu’il a arboré pendant près d’un siècle » et dont le silence est « notre héritage », le défaut d’amour qui laisse « toujours aussi hébété devant le monde, où j’avais été jeté, et où il me fallait exister à ma façon ». Attendre la mort du père pour (lui) dire enfin cette vérité n’est pas, loin s’en faut, le « tuer », ni même le juger, et peu à peu, au contraire, ce livre nous fait comprendre que celui-ci malgré le mépris si difficile à vivre dont il affublait son fils, l’a en réalité élevé, et garde à ses yeux un prestige intact pour lui avoir légué un héritage immense, l’amour des livres, de la langue française et de la musique, le secret de la vie en son archéologie mystérieuse, tout ce qui conduira l’enfant à se passionner pour les vieilles écritures et pour la quête des origines au point que, devenu adulte et libre, ce fils réservera à son père sa tendresse et, sans aucune rancune, une soumission filiale étonnante, qui constitue l’aveu ou la matière d’une réconciliation plus inflexible encore que la paternité. C’est un grand témoignage de fidélité, de loyauté et de transmission que Richard Millet accomplit à contre temps avec d’autres héros français de l’esprit d’enfance comme Péguy, Bernanos ou Boutang.
Si la sensualité excessive de l’écrivain peut donc être comprise comme une réponse à ce manque initial d’amour dont aucun enfant ne se relève jamais véritablement, identifier cet envoûtement dans le dédain du père le conduit à comprendre aussi ce qu’il appelle sa « maladie ». Mélancolie brutale qui tourne ce livre en une terrible méditation sur la mort et l’approche au plus près, dont la crainte ou la fascination constitue la clé de voûte de toute cette vie, surtout depuis qu’il s’est imposé de la fixer par écrit. Car il faut « trouver le courage d’en finir avec l’écriture » : « il faut finir », « en finir », « finissons-en » et « pour en finir » sont les expressions implacables qui jalonnent la lecture et surtout l’écriture de ce livre, comme si cette autobiographie était « un pas décisif vers la mort i.e. son acceptation ». Grâce à Dieu, ce n’est pas à cette extrémité que conduit le travail prométhéen de l’écrivain, mais à un autre coup de théâtre : l’aveu final presque impossible à formuler par lequel il marque sa propre faiblesse intime, la faiblesse originelle, mystérieuse d’une vie « rivé à l’angoisse comme un drapeau à sa hampe (…) un drapeau de chair battant sur une âme malade », mais en quoi, nous le comprenons, réside aussi sa force et grâce à quoi il démontre le courage de cette vie faite d’épreuves pour surmonter cela et qui se termine pourtant dans la relégation : « Je suis mort plusieurs fois ».
Voici donc ce grand livre où Richard Millet répond magnifiquement à ses détracteurs en continuant d’être ce qu’il est et de faire ce qu’il a toujours fait : envers et contre tout l’écrivain authentique continue d’accomplir son œuvre bénéfique et audacieuse. À cet homme d’un courage inouï face à l’adversité, il faut redire notre admiration : parce qu’il déclare maintenant la puissance des forces térébrantes que dès sa jeunesse il a dû déjouer et comment il a inlassablement tenté pour les affronter de sortir, toujours avec flamme, de sa « forteresse intérieure » tandis qu’à l’inverse par les motifs les plus bas (car dans ses essais il voulait seulement alerter sur la déchéance où notre pays allait sombrer) et les manœuvres les plus coupables il était refoulé, relégué et renvoyé à cette forteresse dans l’idée qu’elle deviendrait son tombeau ou du moins qu’il y disparaîtrait à jamais, avec son message détesté de prophète. Non, cette fois Ninive ne s’est pas repentie ! Mais avec Richard Millet comme avec Montaigne ou Pascal, c’est l’écriture qui délivre d’elle le lecteur et l’absorbe dans le projet du livre où ils se survivront. C’est ainsi qu’un pays ne meurt pas. Si un prophète peut être davantage qu’un roi, son livre est sa couronne d’épines ; depuis sa forteresse imprenable elle lui donne à jamais la puissance de débouler sur les assaillants et de leur infliger un revers cuisant et salvateur.
