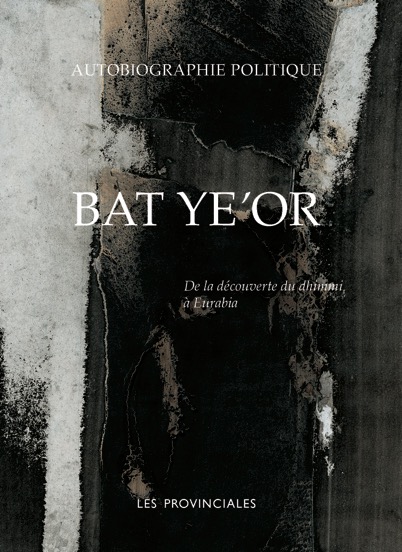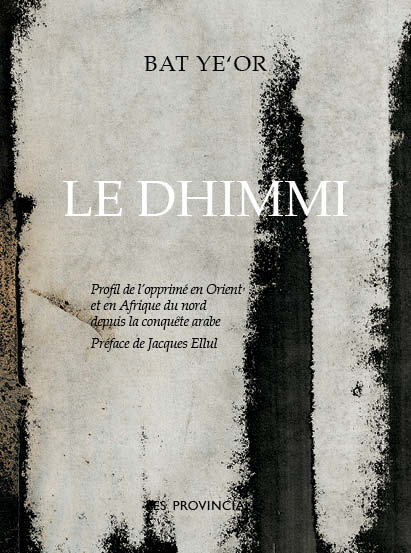« Nul ne ment autant qu’un homme indigné. » Cet aphorisme de Nietzsche désigne assez bien les procédés de certains détracteurs de l’œuvre de Bat Ye’or ; depuis près d’un demi-siècle, avec une opiniâtreté méthodique, certains d’entre eux ont cherché à expulser cette historienne britannique hors du cercle de la scientificité, à l’entourer d’un halo sulfureux, à la déconsidérer comme un esprit irrationnel. Jusqu’à un certain point, ils y sont parvenus. Un paravent conjuratoire s’est dressé qui brouille la réception du travail de Bat Ye’or. Leur dénigrement vertueux a installé dans les esprits l’idée que la spécialiste de la « dhimmitude », c’est-à-dire du statut de citoyens des non musulmans en terre d’islam, aurait glissé vers un bord-à-bord avec les théories du complot.
À la lire, pourtant, on s’aperçoit qu’il n’en est rien. Et que Bat Ye’or n’a rien à voir avec la série X-Files. Nombre d’accusations adressées à sa démarche relèvent de l’allégation. On mesure ainsi, au passage, la bravoure de ceux qui, dans l’institution académique, ont toujours refusé de céder à ce « bashing » facile et ont proclamé la validité de ses travaux : le philosophe Jacques Ellul, dès le début des années 80, et, depuis, l’historien Martin Gilbert, les politologues et historiens des idées Pierre-André Taguieff et Robert Wistrich, qui ont souligné, l’un comme l’autre le caractère opératoire de ses concepts.
La publication, par les éditions les provinciales, de son autobiographie politique est peut-être l’occasion de réviser à la hausse le jugement porté sur ses découvertes. Tout commence dans un Orient jadis immortalisé par Lamartine et Chateaubriand. C’est au Caire, en 1933, que Bat Ye’or a vu le jour dans une famille de la bourgeoisie juive, d’origine française (par sa mère) et italienne (par son père). Il faut lire les pages, très belles, où elle restitue l’atmosphère de cette époque bénie, dans une mégalopole de l’Orient qui apparaît comme une Babel cosmopolite et insouciante. La jeune femme n’a pas encore forgé son pseudonyme et porte son nom d’état-civil : Gisèle Orebi. Se rémémore-t-on encore que les rives du Nil sous mandat britannique furent le havre d’un cosmopolitisme authentique, qui n’avait rien à envier à la Vienne de Freud et de Schnitzler ? De cette Atlantide l’auteur à venir se voudra tout ensemble, l’héritière et l’obligé. A sauts et à gambades, nous avançons vers le moment – l’année 1957 – où il ne sera plus possible à sa famille, en raison de la virulence du sentiment antijuif, de prolonger son séjour dans l’Egypte nassérienne.
Avec franchise, Bat Ye’or raconte cette catastrophe intime, et le délitement progressif d’une socialité miraculeuse, celle des juifs égyptiens, suspendus entre une tradition déjà révolue et un avenir encore infigurable. Gamal Abdel Nasser, donc, ce champion laïque de l’utopie panarabe, dont elle dresse un portrait aigu, mais inquiétant ; la montée parallèle d’un mouvement fondamentaliste né dans les années 20 et promis à jouer un grand rôle dans les difficultés ultérieures de l’Egypte : la Confrérie des Frères musulmans. En historienne, la mémorialiste rend également présent ce que fut le dramatique tournant géopolitique de 1967, après la victoire éclair (et inespérée) de Tsahal, au début du mois de juin, face aux armées arabes. Elle se souvient des paroles prononcées alors par le premier magistrat de France, Charles de Gaulle, flétrissant « un peuple d’élite, sur de lui-même et dominateur ». Formule épochale pour l’auteur en ce sens qu’elle initie une nouvelle époque.
Bat Ye’or a alors trente-quatre ans. Elle est mariée à l’historien britannique David Littman et élève ses enfants. « Peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur »… Comme le sociologue Raymond Aron, elle pressent que ces trois qualificatifs donnent congé à son « monde d’hier » dont elle décide, à peu près simultanément, de demeurer le témoin fidèle. Mais la diatribe présidentielle résilie, aussi, le serment prêté par des hommes libres, au sortir de la Seconde guerre mondiale et de l’Extermination, de nouer avec l’expérience nationale des juifs un lien non négociable d’empathie. Une œuvre, aimait à dire Michelet, est pareille à un « réseau d’obsessions ». Les travaux de Bat Ye’or découleront de la recomposition traumatisante de l’année 1967, presque autant que de l’état de déréliction, à la suite des indépendances de chacun de ces pays, des communautés juives d’Egypte, d’Irak et du Yémen. Dans son autobiographie, Bat Ye’or n’hésite d’ailleurs pas à voir dans le revirement stratégique de la France, mis en œuvre par un commis de l’Etat comme Maurice Couve de Murville (1), l’un des théâtres où s’origine la dévitalisation de l’Europe face à l’islamisme. L’auteur, dont nul n’est forcé d’épouser les convictions politiques bien trempées, n’hésite pas à écrire que « le vieux rêve du Mufti de Jérusalem, unir l’Europe contre Israël, se réalisait dans “la politique arabe de la France” conçue par Couve de Murville, ex-fonctionnaire de Vichy. »
Amplification ? « La diabolisation de l’Occident dans son ensemble », précise l’historienne que nous rencontrons à Paris, est « consubstantielle à la vision du Dar al-Harb » (2). La structure de tant de discours actuels de démission, suggère-t-elle aussi, ne dissimule d’ailleurs aucun plan concerté et machiavélique, « mais plutôt une succession malheureuse de lâchetés » qui se sont poursuivies jusqu’à nos jours, « souvent motivées par l’intérêt économique » ; ces abdications expliqueraient, selon elle, la constitution de l’axe complice qu’elle nomme « Eurabia ». Prisonnière de ses ressassements, Bat Ye’or ? En fait sa vraie ambition, éloignée des théories du complot, est de dénoncer un engrenage de reculs. Et, malgré les apparences, elle ne souffle pas davantage sur les braises du clash des civilisations. Non. L’historienne en appelle plutôt aux « musulmans éclairés », contre l’islam politique et contre l’obscurantisme. « S’ils se joignent à nous, renchérit-elle, nous nous libérerons tous de la menace djihadiste… »
Alexis Lacroix, L’Express n°3475 du 7 février 2018.
• Autobiographie politique, par Bat Ye’or, Les provinciales, 352 p., 24 €.
• Réédition chez le même éditeur de son étude Le Dhimmi.