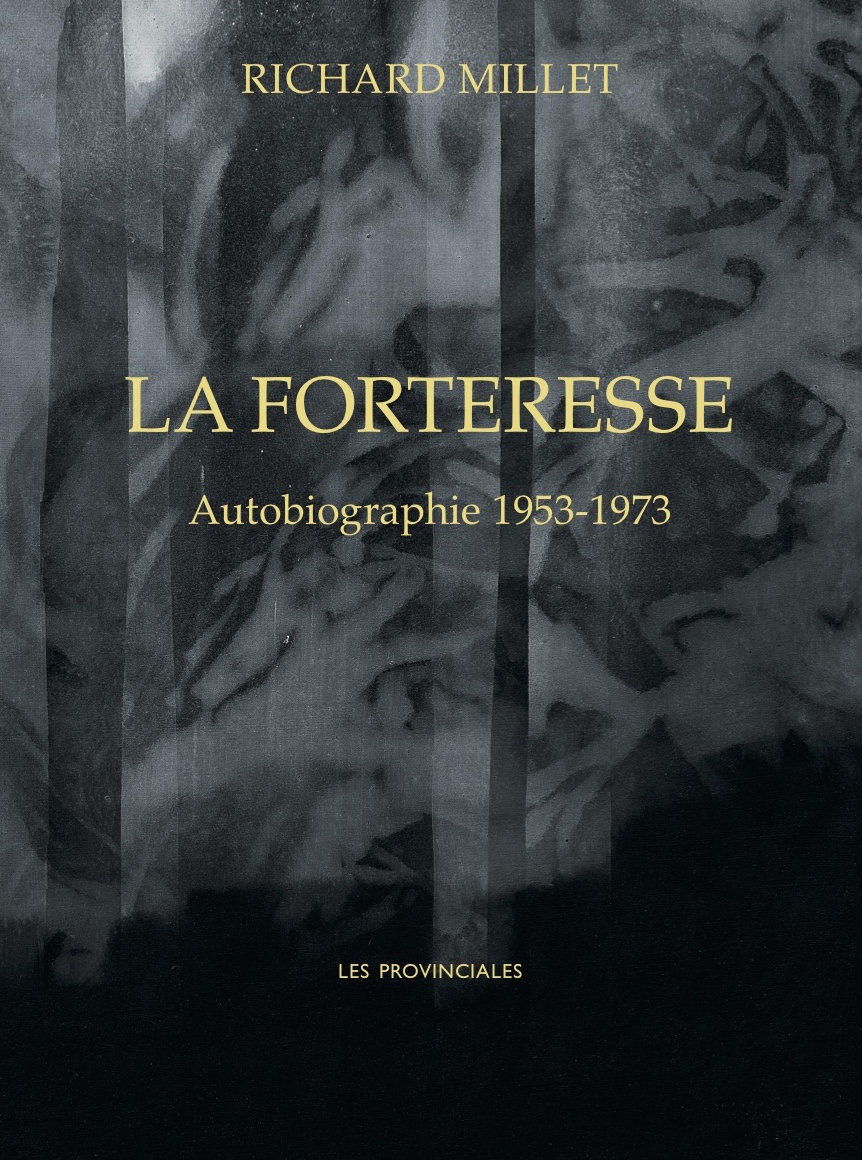Si Richard Millet est définitivement infréquentable pour les sectateurs du Bien, ouvrir son nouvel opus devrait faire comprendre à tout lecteur de bonne fois qu’il se trouve face à une figure littéraire majeure, affirmant : « Écrire sur soi, c’est se faire l’alchimiste de l’insignifiant, autant que du perdu : muer l’or en déchet, parce que la vérité que je cherche sur moi ne brille pas forcément, ou que sa lumière est encore de la nuit. » Dans cette autobiographie tout en méandres et jeux d’échos, il retrace les vingt premières années de son existence, au cœur d’une Forteresse intérieure « peuplée de défunts, de personnages de fiction, de fantômes, de figurations rêvées ». Elle est à la fois un refuge face à un monde « où a vérité est infiniment blessée par l’inversion de toutes les valeurs », qu’il observe par ses meurtrières, et une prison, dont il sort sporadiquement par la grâce des femmes, de la musique (Pierre Boulez, Terry Riley, etc. ; pour des goûts de réactionnaire, on repassera) ou de l’écriture.
Il y a des pages sublimes sur Rimbaud, illumination des seize ans de Richard Millet, mais aussi sur les femmes aimées, d’autres, terribles, sur son père ou son frère. Certaines sont cinglantes : les psychiatres ? « Des gestionnaires de l’effondrement spirituel. » La définition est parfaite. De la haute Corrèze à Paris, via le Liban, un chemin escarpé se dessine, étant bien entendu que les années d’enfance et d’adolescence sont à la source vive où l’adulte vient s’abreuver?
Alfred Lévy, Valeurs actuelles du 1er décembre 2022
• La Forteresse de Richard Millet