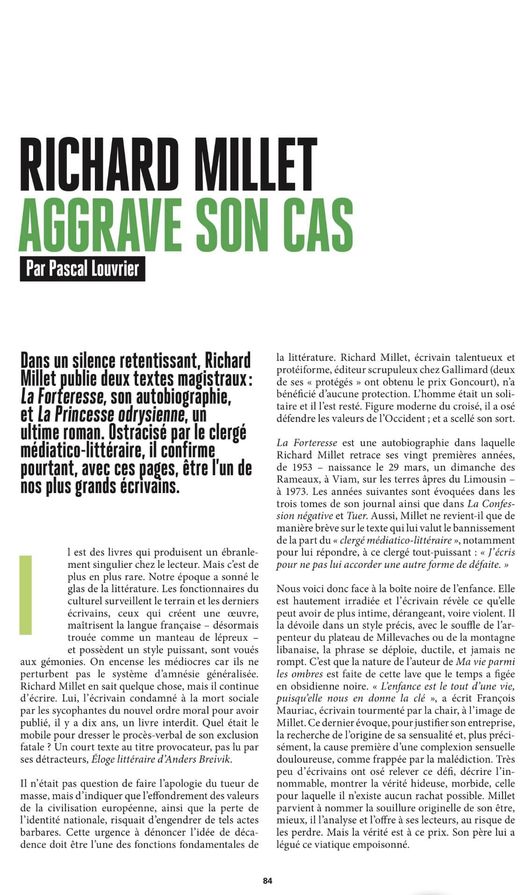 Il est des livres qui produisent un ébranlement singulier chez le lecteur. Mais c’est de plus en plus rare. Notre époque a sonné le glas de la littérature. Les fonctionnaires du culturel surveillant le terrain et les derniers écrivains, ceux qui créent une œuvre, maîtrisent la langue française – désormais trouée comme un manteau de lépreux – et possèdent un style puissant, sont voués aux gémonies. On encense les médiocres car ils ne perturbent pas le système d’amnésie généralisée. Richard Millet en sait quelque chose, mais il continue d’écrire. Lui, l’écrivain condamné à la mort sociale par les sycophantes du nouvel ordre moral pour avoir publié, il y a dix ans, un livre interdit. (…) Richard Millet, écrivain talentueux et protéiforme, éditeur scrupuleux chez Gallimard, n’a bénéficié d’aucune protection. L’homme était un solitaire et il l’est resté. Figure moderne du croisé, il a osé défendre les valeurs de l’Occident ; et a scellé son sort.
Il est des livres qui produisent un ébranlement singulier chez le lecteur. Mais c’est de plus en plus rare. Notre époque a sonné le glas de la littérature. Les fonctionnaires du culturel surveillant le terrain et les derniers écrivains, ceux qui créent une œuvre, maîtrisent la langue française – désormais trouée comme un manteau de lépreux – et possèdent un style puissant, sont voués aux gémonies. On encense les médiocres car ils ne perturbent pas le système d’amnésie généralisée. Richard Millet en sait quelque chose, mais il continue d’écrire. Lui, l’écrivain condamné à la mort sociale par les sycophantes du nouvel ordre moral pour avoir publié, il y a dix ans, un livre interdit. (…) Richard Millet, écrivain talentueux et protéiforme, éditeur scrupuleux chez Gallimard, n’a bénéficié d’aucune protection. L’homme était un solitaire et il l’est resté. Figure moderne du croisé, il a osé défendre les valeurs de l’Occident ; et a scellé son sort.
La Forteresse est une autobiographie dans laquelle Richard Millet retrace ses vingt premières années (…). Ce dernier évoque, pour justifier son entreprise, la recherche de l’origine de sa sensualité et, plus précisément, la cause première d’une complexion sensuelle douloureuse, comme frappée par la malédiction. Très peu d’écrivains ont osé relever ce défi, décrire l’innommable, montrer la vérité hideuse, morbide, celle pour laquelle il n’existe aucun rachat possible. Millet parvient à nommer la souillure originelle de son être, mieux, il l’analyse et l’offre à ses lecteurs, au risque de les perdre. Mais la vérité est à ce prix. Son père lui a légué ce viatique empoisonné.
Il arrive que l’autobiographie soit le genre retenu par l’écrivain pour donner de lui-même une image retouchée, valorisée, surtout à notre époque où le narcissisme est devenu une pratique olympique. Ici, rien de tel. Millet déteste tout de lui, à commencer par son corps, qui porte à présent les stigmates du cancer, et affirme que « la haine de soi étant, après tout, un bâton aussi commode que le narcissisme pour cheminer ici-bas ».
Tel Œdipe avant l’ordalie. Millet n’évite rien et franchit tous les obstacles dans le seul but de comprendre pourquoi il s’est complu dans la forteresse qu’il a lui-même érigée, dans l’espoir d’échapper au monde des adultes et de préserver l’enfant qui vit toujours en lui. Un enfant taiseux, timide, blessé par la médiocrité généralisée, effrayé par une sensualité exubérante, traumatisé par des événements exhumés des limbes, l’ensemble étant tenu dans l’ombre paternelle, incommensurable. (…) Le futur écrivain découvre la littérature et la musique grâce à cet homme qui ne souhaitait pas d’enfant et était incapable du moindre signe d’amour. Écrire pour combler le manque et tenir en respect l’idée de suicide. Millet, au scalpel : « J’en appelle au néant d’où le sperme paternel m’a tiré pour me projeter dans la sphère maternelle, me faisant passer de la nuit sidérale à l’humide chaleur d’un ventre que j’imagine orangée, et où je n’ai d’abord été qu’un crachat, comme tout à chacun, mais qui me laisse l’impression indéfectible, de l’être resté, aux yeux de mon père comme aux miens. » (…) Millet renforce ainsi au fil des ans la forteresse qui le protège du bruit, des odeurs, de ses phobies, et surtout de la mesquinerie des hommes, n’ouvrant, malgré lui et à ses dépens, que deux meurtrières, celles des femmes et de la guerre.
Millet se livre totalement, entièrement, sinon à quoi bon cette confession exemplaire. Il dit la vanité de toute chose, le refus daller vers autrui, la volonté de ne vivre que par et pour l’écriture, dans une France parodique et post-littéraire, qui a laissé mourir la paysannerie et donc son univers familial. Il espère encore l’amour que ses deux filles pourraient lui porter. Il révèle, avec courage, la maladie dont il souffre et qui s’est déclarée à l’âge de 19 ans. Millet descend jusque « dans l’égout ». C’est la scène dans le cinéma où l’on projette juste avant la nuit de Chabrol. Sa mère est présente. J’avoue que l’effroi m’a saisi en la lisant. La littérature, décidément, est puissante quand elle est du côté du Mal.
Cette autobiographie ne ressemble à aucune autre. Elle éclaire sous un soleil blafard l’auteur qui tient à la fois d’Holden Caulfield et de Bartleby. Il a voulu tout arrêter, découragé par l’entreprise. (…)
Le crime de Richard Millet aura été de lézarder les murs de la forteresse où, aveugles et sourds, nous nous retranchons, dans l’espoir de jouir encore un instant d’un pitoyable bonheur. Avec son autobiographie, il aggrave son cas en révélant sa nature complexe, contradictoire, glaçante parfois, et nous oblige à faire notre propre introspection. « Il se peut enfin que le mot de deuil recouvre aussi une énigmatique forme d’amour – et que j’aie toujours été peu ou prou amoureux de ma mort, vivre n’étant qu’une suite de variations sur le deuil, puisque nous ne cessons de mourir à nous-mêmes ».
Aucun pardon ne lui sera accordé ici-bas.
Pascal Louvrier, Causeur n°105, octobre 2022.

