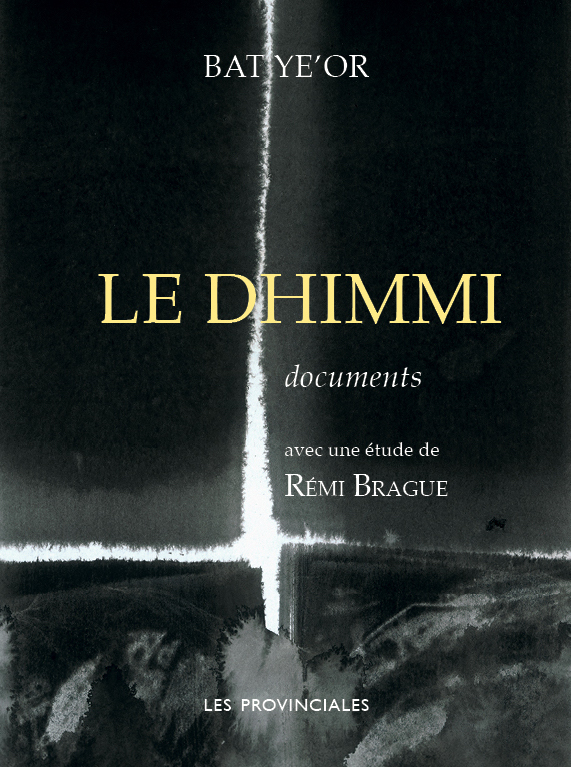Le prophétisme est une prise de conscience historique
Pour dessiner les traits d’une société redoutée dans ses tendances totalitaires, de puissants écrivains ont publié toutes sortes de fables au XXe siècle. Kafka a suscité un univers oppressant dans lequel l’individu se trouve radicalement isolé face à un ordre impénétrable qui lui impose sa Loi. Canetti a insisté davantage sur la dégradation inexorable des relations entre les personnes avant la catastrophe. Chesterton a décrit la suspicion mutuelle sous la forme libre d’un cauchemar où chacun croit combattre l’ennemi radical alors que celui-ci n’est que son vis-à-vis antagoniste. Jünger a situé dans un passé mythique la dévastation opérée par la barbarie sur des réalités sociales délicates et la poésie de la vie primitive. Orwell au contraire a projeté dans le futur d’une date prise au hasard ce qu’il voyait s’ébaucher grossièrement sous ses yeux. Zinoviev a longuement exploré avec ironie les hauteurs béantesdu système totalitaire dans lequel il avait effectivement vécu…
Bat Ye’or a vécu, elle, Fille d’Égypte, dans une société islamisée qui avait été modifiée, adoucie par l’influence européenne. Elle a vu celle-ci s’effondrer avant d’en être expulsée, en 1957, parce qu’elle était juive, sous l’effet des ambitions et des contradictions de la « révolution ». Ce qu’elle n’a pas pu observer sur place, elle l’a reconstitué librement de l’extérieur, depuis son exil forcé. Dans son étude sur Les Juifs en Égypte publiée en 1971, précisément à l’époque qu’elle décrit dans Ghazal, figurent pour la première fois les noms d’anciens nazis ayant trouvé refuge par centaines, après la Seconde guerre mondiale, dans ce pays accueillant où ils avaient atteint des positions éminentes, souvent sous un nom musulman. Mais le fait…
Michel Onfray attaque le gilet jaune de l’édition
Non sans embarras Michel Onfray a déclaré dans une vidéo de sept minutes publée le 19 septembre 2023 sur sa propre chaîne, et montrée plus de 100 000 fois : « Je trouve que c’est un petit peu fort de prétendre que j’ai été… que je suis coupable de…
La consistance du Journal de Richard Millet
Avec ces trois volumes, ce sont nos vingt premières années du XXIe siècle, 2000-2019, qui sont vécues de l’intérieur, en mille cinq cent pages rapides et fortes. « Ce journal n’a de sens qu’à condition de ne jamais relire ce que j’y note. » C’est cela, bien sûr, qui donne à une telle entreprise sa valeur unique, démonstrative, exemplaire :