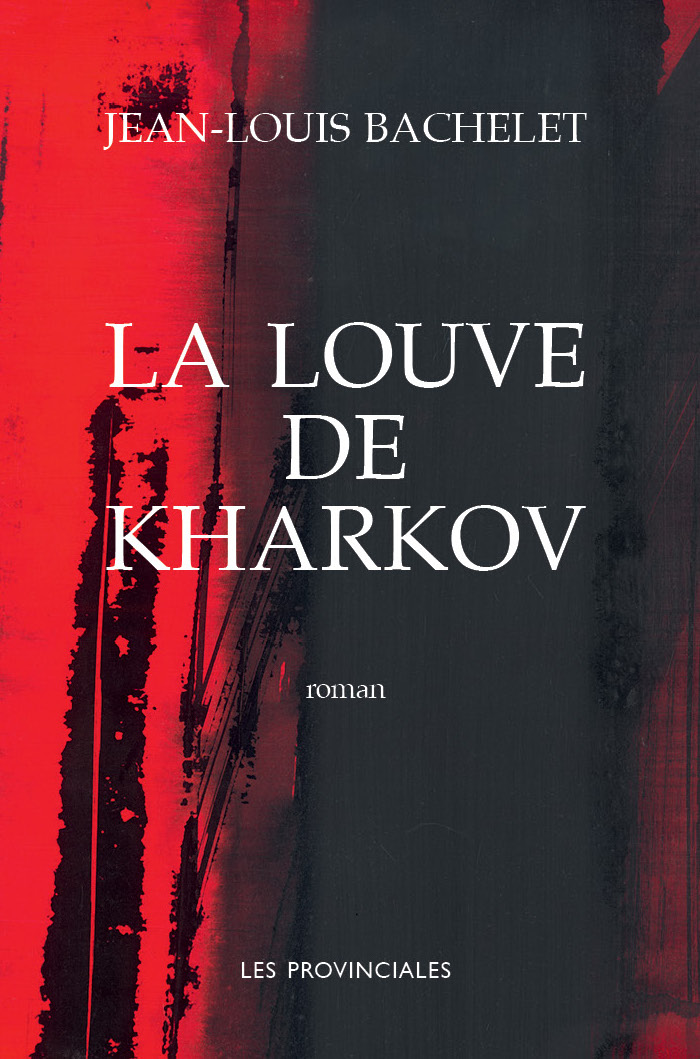Dans son ouvrage Le temps scellé, le cinéaste russe Andreï Tarkovski donne une destination bien étonnante à l’œuvre artistique, de quelque nature qu’elle soit. Selon lui, elle n’a d’autre but que de nous préparer à notre propre mort. Si singulière que soit cette déclaration, elle définit pourtant une disposition d’esprit caractéristique de l’artiste russe. Dostoïevski, condamné à mort pour activité révolutionnaire, échappe à la peine capitale in extremis. Le Tsar avait voulu donner une leçon à ce jeune imprudent, et commué sa peine en cinq ans de travaux forcés, quelques secondes avant son exécution. De cet instant terrible où il crut devoir dire adieu à la vie, il semble que l’auteur de Crime et Châtiment ait tiré toute son œuvre à venir.
Il est un fait curieux que Soljénitsyne n’ait jamais évoqué ce célèbre précédent dans ses livres. Arrêté en pleine guerre mondiale, condamné à huit ans de goulag, frappé alors qu’il vient juste d’être libéré d’un cancer pour lequel on lui donne trois semaines à vivre, c’est dans l’acceptation totale de sa disparition imminente qu’il prend la route, la veille du nouvel an 1954, pour aller, comme il l’écrit, mourir à l’hôpital de Tachkent.
S’il a échappé miraculeusement à la mort, Soljénitsyne, comme Dostoïevski, convient dès le début de ses mémoires que sa vie revêt un sens nouveau : elle ne lui appartient plus. Elle est une vita nova accordée par grâce divine, après l’enfer.
Mathématicien de formation, valeureux capitaine d’artillerie pendant la grande guerre patriotique, Soljénitsyne s’était pourtant voué très tôt à la littérature. Si les circonstances en ont décidé autrement, ce désir a trouvé matière à s’exprimer dans l’environnement le plus hostile qui soit : le camp de concentration. Là-bas il n’aura pas à éprouver la « terreur de la page blanche » : Il lui est interdit d’écrire. Alors il va exercer sa mémoire. Apprendre par cœur des vers, puis de la prose. Il répète chaque jour ce qu’il a composé mentalement la veille, en ajoutant quelques phrases. Au bout de cinq ans, la récitation intérieure de ce livre virtuel lui prend une semaine par mois. Lorsqu’il est libéré, et une fois guéri du cancer, il va passer dix ans en relégation, durant lesquelles il s’applique à coucher sur le papier tout ce qu’il a en tête, avant de rouler les feuillets dans des bouteilles, et de les enterrer dans son jardin. Comme il l’écrit lui-même, c’est un destin étrange que celui d’un auteur qui écrit en priant pour ne pas être lu !
On sait ce qu’il en sera par la suite. À la faveur du coup de tonnerre du XXe congrès du PCUS qui lève le voile sur les crimes de Staline, il fond dans la brèche ouverte par les foudres de Khroutchev, et fait publier Une journée d’Ivan Denissovitch. C’est un véritable tsunami littéraire. Soljénitsyne, à presque cinquante ans, sort du néant où il errait depuis vingt ans. Mais la menace ne cesse pas pour autant. L’ère Brejnev vient placer au dessus de son cou une hache toute neuve, faite des mêmes menaces d’emprisonnement et de mise à mort. Il est devenu d’autant plus dangereux que ses œuvres se sont répandues en occident. Lorsqu’il est expulsé en 1974, les Français découvrent à la télévision, grâce à Bernard Pivot, le visage de ce prophète sexagénaire dont le regard bleu acier semble témoigner à lui tout seul de l’immortalité de l’âme.
Il lui faudra alors combattre contre une nouvelle tyrannie, plus insidieuse encore que celle dont il est sorti. En Occident, son œuvre est reçue comme un manifeste anti-soviétique – et rien de plus. Soljénitsyne, c’est ce dissident qui a dénoncé les goulags. Point. Et s’il est anti-soviétique, c’est nécessairement qu’il est démocrate. Logique, non ? Hélas, les supporters de l’auteur du « premier cercle » qui se réjouissaient à l’idée d’apporter avec lui un souffle nouveau aux rangs de la gauche française vont vite déchanter. Car leur champion, non content de multiplier les déclarations réactionnaires, développe à l’envi, entre deux confessions de foi orthodoxe, son admiration pour la Vendée catholique et royale de 1793, et son mépris pour la pensée des Lumières. Trahison ! Tout cela n’aurait pas revêtu le même sens si l’on avait pris Soljénitsyne pour ce qu’il est, à savoir un écrivain, un romancier, absolument étranger à la notion « d’engagement » sans laquelle, chez nous, il n’est plus possible de rien faire. Car Soljénitsyne, c’est avant tout une langue. Ses traducteurs en savent quelque chose. Durant ses années de relégation, il a développé un style qui bouscule la langue soviétique, sorte de novlangue qui, au fil des ans, avait dévoré le corps vivant du parler russe. Soljénitsyne, comme Dostoïevski à la maison des morts, s’est mis à l’écoute du parler populaire, du parler paysan, et de l’argot des camps. Sa phrase peut s’imprégner de telle particularité locale si le propos qu’il développe s’y prête. Il peut écrire une page en imitant la langue qu’on parle à Kazan, ou construire une phrase où pointera un mot inusité depuis deux siècles. Caractéristiques qui, hélas, sont bien sûr intraduisibles, comme cet ordre des mots, qui chez nous est très normé, quand en Russie, il peut changer en fonction des idées qu’on veut mettre en lumière.
Le fait est que la manière de Soljénitsyne est tellement singulière, que beaucoup en Russie ne savent plus le lire. Pourtant, c’est dans ce style qui lui est propre qu’il faut goûter l’esprit de cet immense écrivain. Face à l’homo sovieticus, créature sortie du moule révolutionnaire et destinée à se reproduire à l’identique, Soljénitsyne présente le miroir de la Russie réelle. Le miroir de sa terre, cette terre gorgée du sang d’une paysannerie martyre. Le miroir des ses hommes, tous différents, tous riches de leurs propres manières, de leurs propres traditions, de leur propre vécu, et que le camp a voulu égaliser en les revêtant de cette même sinistre veste ouatinée, et en leur plaçant une pioche entre les mains.
Alors il ne faut pas s’étonner de ce que Soljénitsyne se soit empressé de revenir en Russie, une fois le mur tombé, quand il s’aperçut qu’on était en train de réussir en Occident ce que Brejnev avait raté chez lui. Car l’égalité qui sévit en occident, et particulièrement en France, n’a d’autre projet que de nous faire tous pareils. Sans camp, et sans terreur. Notre véritable ennemie est-elle la privation de liberté ? Est-elle la mort ? Pour Soljénitsyne, il y a pire, et ce pire menace l’Occident. Car comme le dit le héros du Premier Cercle avant d’être arrêté, « ce n’est pas l’océan qui noie l’homme, c’est le marécage ».
Jean-Louis Bachelet, Livr’arbitres n°44, à paraître.